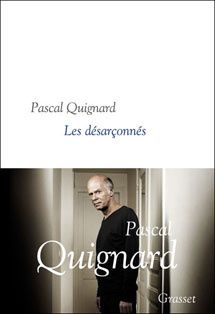Le dernier roman de Patrick Modiano remet nos pas dans ce Paris labyrinthique auquel il nous a habitués. Une ville éternelle, mais en perpétuelle transformation, où des enseignes se superposent comme autant de palimpsestes. Où les noms de rues résonnent d'étrangeté, à force d'être associés à des déplacements en zig-zag dans l'espace et dans le temps.
Les personnages changent d'identité, ou bien se superposent, eux aussi, dans la ronde d'un retour (éternel?), où un couple d'aujourd'hui reproduit le souvenir d'un autre, disparu, mais peut-être pas. Un fil d'Ariane fragile au possible emmène le narrateur à la recherche d'un passé jamais vraiment passé, dont la blessure est latente et pernicieuse. Ce fil qu'il a cherché à arracher, en détruisant les chapitres des "romans" où il racontait son histoire. Mais celle-ci ne le lâche pas, jusqu'à la dernière phrase où, abandonnant la forme de l'histoire d'un certain Daragane, le narrateur lance avec désespoir, comme s'il reprenait la parole:"... et il vous faut un peu de temps encore pour vous rendre compte qu'il ne reste plus que vous dans la maison".
L'enfant qui vient de réaliser cela a sept ans. Et cet abandon qu'il pressentait, lui qui guettait tous les soirs les bruits de voitures s'éloignant, cet abandon ne l'a pas quitté. C'est pourquoi, malgré sa répugnance, il saisit le fil du temps. Qui le ramènera au même endroit, il ne pouvait en être autrement.
Le lecteur lui non plus ne peut plus quitter ce texte, où l'auteur sème des indices autour de trois moments-clés: l'enfance de Daragane, ses vingt deux ans, et puis l'année 2013 où il reçoit d'étranges personnes, en écho aux deux temps précédents, échos déformés, insistants,vertigineux.
Le héros de ce récit semble avoir passé une vie à attendre de savoir qui étaient ces gens qu'il accompagnait comme un satellite égaré; dont les noms et les vies émergent, puis disparaissent. Des hasards successifs, des vies dérisoires, sordides, à la limite des lois. Rien de stable, des chambres d'hôtels de dernière catégorie, des maisons abandonnées, une école démolie, un quartier disparu. Comme une menace toujours présente que le néant est là, sous la surface d'une eau grise où crèvent des bulles.
Le néant où retombent tour à tour Torstel, Colette Laurent, Roger Vincent, Jacques Perrin de Lara, Joséphine-Chantal Grippay, et tous les autres, la mère sans nom, et Annie Astrand,... celle qui aurait pu lui expliquer, mais qui s'est dérobée. Peut-on expliquer le manque ? Encore faudrait-il le nommer. Manque d'amour, de courage, de fierté ? Tellement ordinaires.
On ne sort pas tranquille de ce livre. Pas plus que de tous ceux de Patrick Modiano.
"Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier" Patrick Modiano Gallimard 2014




 Un médecin de l'âme de ma connaissance disait un jour, pensif : " Nous avons une connivence dégueulasse avec la mort." Est-ce là cette "chose" innommable qu' Holly et Eric ont rapportée avec eux, depuis la Sibérie avec leur enfant adoptée ? Une vague et fétide odeur de pourri flotte dans l'air que respire Holly, ce matin du 25 décembre où tout semble aller mal ; les parents se sont réveillés trop tard, Tatiana ne sort pas de sa chambre, la neige est en train de tout ensevelir, les amis ne viendront pas pour le repas de Noël, à peine accueillie à l'aéroport la grand-mère doit être transportée à l'hôpital.
Un médecin de l'âme de ma connaissance disait un jour, pensif : " Nous avons une connivence dégueulasse avec la mort." Est-ce là cette "chose" innommable qu' Holly et Eric ont rapportée avec eux, depuis la Sibérie avec leur enfant adoptée ? Une vague et fétide odeur de pourri flotte dans l'air que respire Holly, ce matin du 25 décembre où tout semble aller mal ; les parents se sont réveillés trop tard, Tatiana ne sort pas de sa chambre, la neige est en train de tout ensevelir, les amis ne viendront pas pour le repas de Noël, à peine accueillie à l'aéroport la grand-mère doit être transportée à l'hôpital.